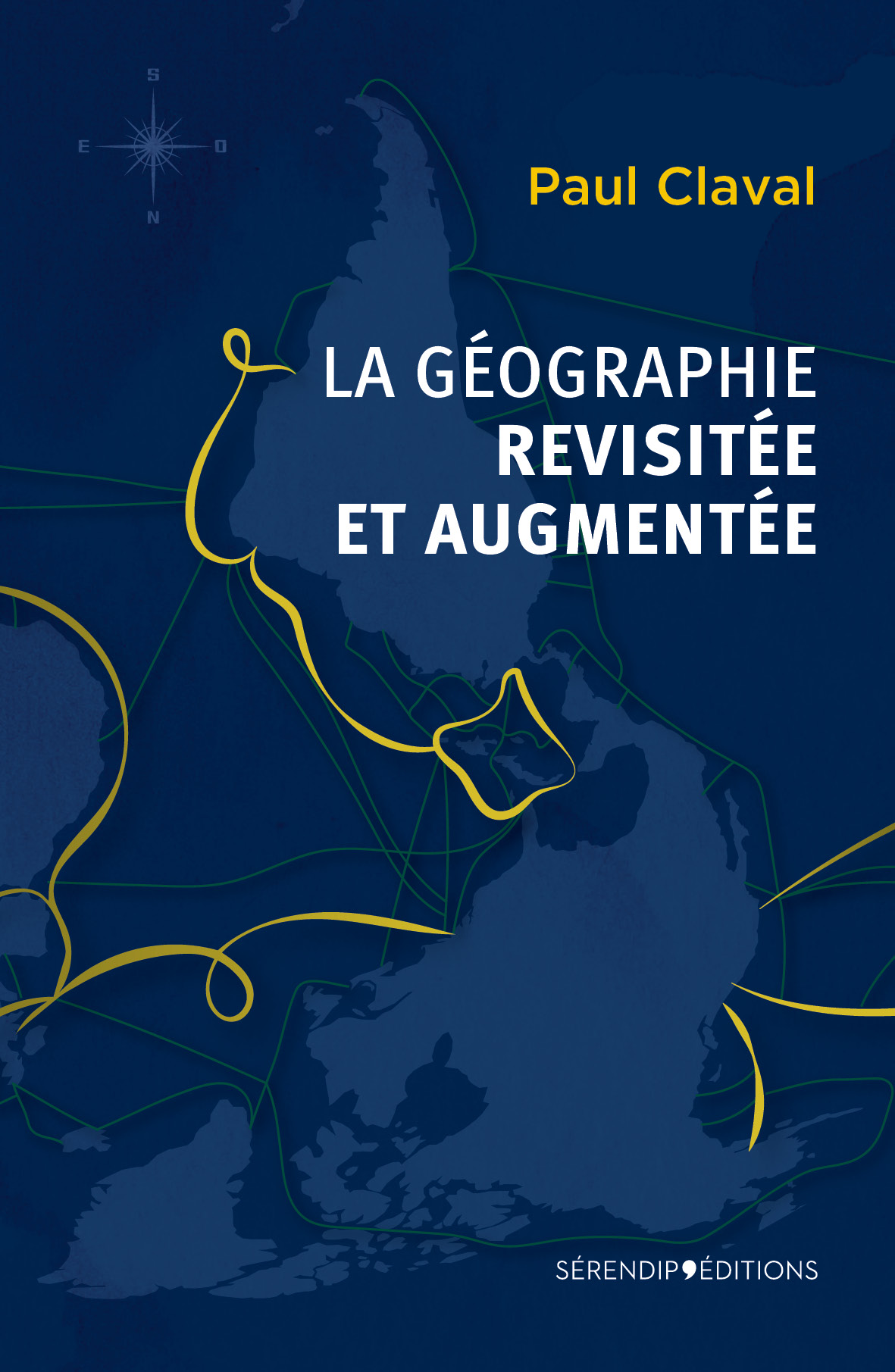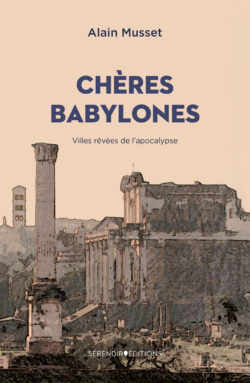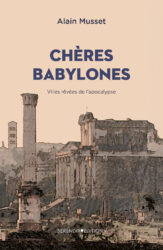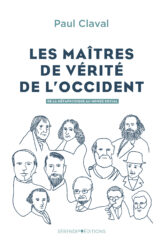Le but de cet essai, le 4e dont le promoteur d’une approche culturelle de la géographie, nous a confié l’édition ? Réexaminer la géographie humaine pour mieux comprendre sa nature, mesurer ses apports et analyser l’enrichissement contemporain de son champ. La géographie humaine en tant que discipline, mas seulement : par-là, Paul Claval entend aussi la dimension spatiale de la culture dont chaque individu est porteur, et qui combine expérience du monde, pratiques, savoirs et croyances.
La géographie revisitée et augmentée
Le but de cet essai, le 4e dont le promoteur d’une approche culturelle de la géographie, nous a confié l’édition ? Réexaminer la géographie humaine pour mieux comprendre sa nature, mesurer ses apports et analyser l’enrichissement contemporain de son champ. La géographie humaine en tant que discipline, mas seulement : par-là, Paul Claval entend aussi la dimension spatiale de la culture dont chaque individu est porteur, et qui combine expérience du monde, pratiques, savoirs et croyances.
25,00 €Add to cart
DÉTAILS TECHNIQUES
Extrait
J’ai été de ces enfants « amoureux de cartes et d’estampes » que la géographie faisait rêver ; j’ai eu par la suite la chance d’enseigner cette discipline et de lui consacrer une vie de recherche. M’intéressant à son histoire, aux problèmes épistémologiques qu’elle pose et au rôle qu’elle joue dans notre monde, j’en ai exploré diverses facettes. En 2007, j’ai décidé de les réexaminer pour en approfondir l’étude. J’y ai consacré une série d’ouvrages (liste en fin de chapitre). Le moment est venu de tirer les conclusions de cette revisite de la géographie. L’acquis des approches descriptives ou fonctionnalistes d’hier y est enrichi par la perspective culturelle.
L’image qui s’en dégage est plus large et plus complexe que celle qui est généralement partagée. La place de la géographie n’a, en bien des sens, jamais été aussi grande dans la vie des hommes que dans le monde devenu plus transparent qui est le nôtre, mais dans bien des cas, le progrès a rendu moins utile l’acquisition des connaissances qu’elle apportait. Il était difficile de vivre sans savoir s’orienter et se localiser. Le GPS, les satellites de géolocalisation et les ordinateurs qu’ils alimentent repèrent la position des gens et leur indiquent les itinéraires à suivre pour se rendre en tel ou tel lieu : plus personne ne se perd ! Le problème géographique que posent les déplacements n’a pas disparu, mais sa solution n’est plus à la charge de chacun.
Les voyages, les souvenirs qu’on en ramène, les reportages, les romans, les tableaux, les cartes postales et autres photos, le cinéma et la télévision ouvrent à chacun une expérience de l’ici et de l’ailleurs qui n’a jamais été aussi variée. Cela stimule l’envie de découvrir d’autres environnements, d’autres paysages, d’autres peuples, d’autres mœurs et d’autres façons de vivre, d’habiter, de s’insérer dans la nature et de la transformer. Les flux touristiques ont explosé : à l’échelle mondiale, on comptait 40 millions de déplacements internationaux en 1950 et un milliard en 2019 ! La soif d’expériences géographiques et les pratiques et connaissances qui l’accompagnent n’ont jamais été aussi fortes, mais ce secteur est catalogué sous les rubriques du tourisme ou du loisir plutôt que sous celle de la connaissance de la Terre.
La géographie que vivaient et connaissaient les gens est longtemps restée celle de cercles de vie étroits. Les savoir-faire et les pratiques qu’elle impliquait se transmettaient largement par imitation et n’étaient pas toujours verbalisés. Celle dans laquelle nous évoluons s’est démesurément élargie ; les expériences qu’elle fait naître et les pratiques et connaissances qu’elle mobilise sont diffusées par de multiples chenaux. La façon dont elle est souvent évoquée dans la presse, à la radio ou à la télévision ne parle pourtant guère de cette mutation. On s’y gausse volontiers de la géographie qui demandait aux enfants de mémoriser la liste des départements, des préfectures et des sous-préfectures en France, et les noms des États et de leurs capitales à l’étranger. Cette conception de la discipline a fait place à d’autres depuis longtemps. Elle n’était pas absurde quand elle s’était imposée : elle cherchait à doter chaque jeune de cadres spatiaux qui lui permettraient, par la suite, de se situer et de comprendre où se déroulaient les événements importants sans avoir à se reporter sans cesse à des documents écrits ou visuels, plus rares et moins accessibles qu’aujourd’hui. La conscience nationale se trouvait en même temps renforcée par l’accent mis sur le territoire national. La mémorisation de ces cadres apparaît aujourd’hui absurde dans la mesure où les critères de leur choix nous semblent douteux et où l’accès facile à de multiples sources documentaires rendent inutile de les connaître par cœur.
La place officiellement reconnue à la géographie a évolué et n’est pas la même dans toutes les civilisations. Dans le monde musulman, la condamnation des images par le Coran a limité la place accordée aux cartes dans l’enseignement, et du coup, celle de la géographie. Certains pays n’ont jamais considéré que la mémorisation de données toponymiques et du tracé des fleuves et des frontières était indispensable à l’éducation de leurs enfants. En Grèce, dont le territoire comportait au XIXe siècle, au moment où se formait le Royaume, d’importantes minorités sur lesquelles on préférait rester discret, la présentation des légendes grecques relatives aux différentes parties du pays (la laographie) rappelait leur hellénisation ancienne et remplaçait la géographie . Aux États-Unis, la formation civique reposait sur l’initiation aux techniques de base de la vie démocratique – à savoir la décision collective par le vote et les procédures qu’elle mobilise – et n’impliquait pas d’enseignement systématique de la discipline. J’ai toujours été frappé de l’ignorance du monde qui en résultait jusque dans les milieux instruits : je me souviens d’un professeur de chirurgie de la Faculté de médecine de l’Université du Minnesota, à Minneapolis, me disant : « À Paris, vous n’avez pas la même perception des problèmes d’Israël que nous : Tel Aviv est si proche de chez vous ! ».