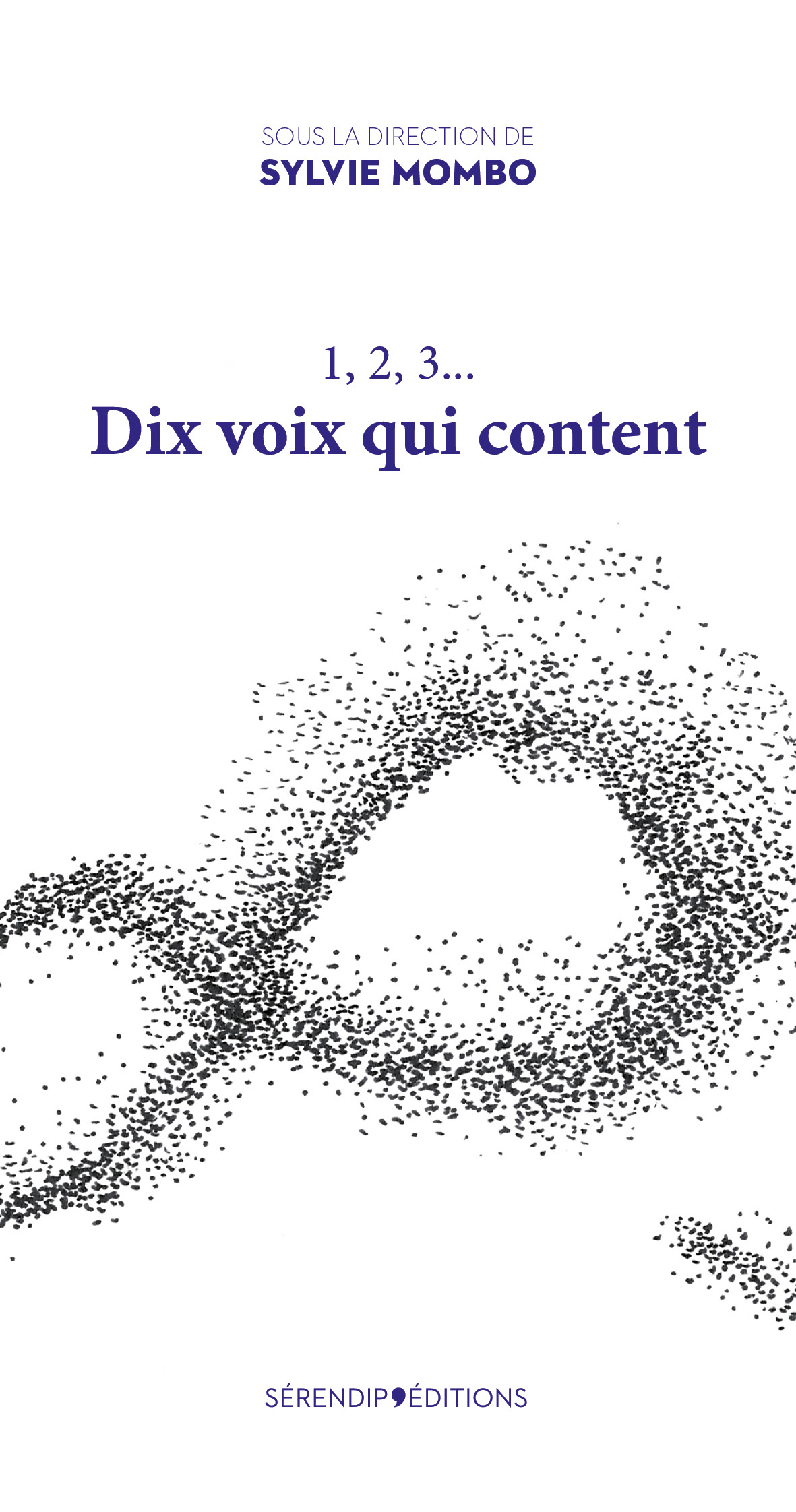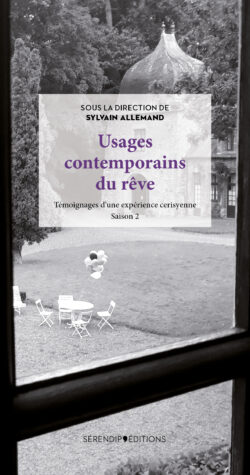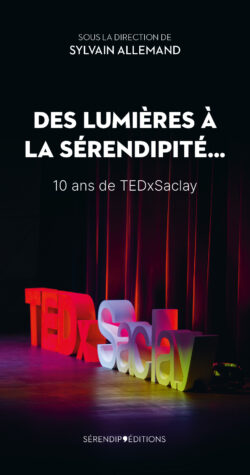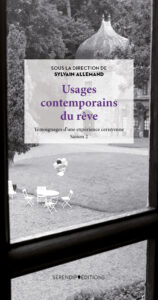Ce recueil de conversations est une invitation à découvrir un métier singulier à travers dix parcours de femmes et d’hommes qui le vivent et le pratiquent avec passion, chacun à sa façon. De l’hôpital à la prison, dans les théâtres, les écoles, les musées et les médiathèques, dans la rue et même dans le métro, à l’improviste !… Ces amoureux du verbe sillonnent le pays (et parfois le monde) pour partager des contes, des mythes ou des récits de vie aux allures légendaires. En se prêtant au jeu du souvenir, elles et ils livrent à Sylvie Mombo, leurs expériences et questionnements, leurs (in)certitudes, leurs envies… Chacune de ces voix est résolument singulière, quant à l’ensemble, il résonne comme un appel à honorer ce qu’il y a de plus intrinsèque chez nous autres les humains, notre capacité à nous (ré)unir.
Avec les témoignages de Muriel Bloch, Nathalie Bondoux, Debora Di Gilio, Catherine Fonder, Patrick Fischmann, Eric Lauret, Karine Mazel, Hélène Palardy, Charles Piquion et Kamel Zouaoui.
Et une postface d’Inès Cazalas, maîtresse de conférences en littérature comparée à l’Université Paris Cité.