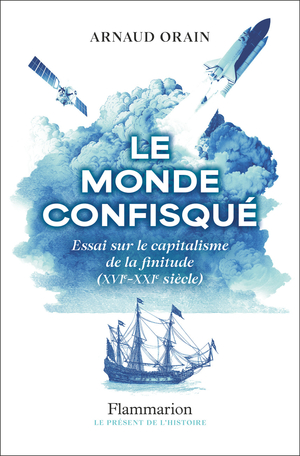Entretien avec Arnaud Orain
Il est des livres qui, par on ne sait quel mystère, paraissent à un moment on ne peut plus opportun pour éclairer des faits d’actualité qui, de prime abord, peuvent paraître extravagants, inexplicables, une illustration supplémentaire d’un monde qui irait à vau-l’eau, sens dessus dessous. C’est le cas du livre d’Arnaud Orain – Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVI-XXIe siècle) – publié chez Flammarion et disponible en librairie depuis le 22 janvier 2025 soit quelques jours à peine après deux faits qui ont pu surprendre pour ne pas dire interloquer.
Le premier, c’est les déclarations de Trump à quelques jours de son investiture, le 20 janvier, annonçant son intention de réintégrer le détroit de Panama dans le giron des États-Unis, d’acheter le Groenland, de faire du Canada le 51e État.
Le deuxième, c’est la photo qui donne à voir une brochette de dirigeants de la Tech – Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk… – qui ont fait « acte d allégeance » au nouveau président.
Deux événements qui prennent tout leur sens à la lecture de l’ouvrage d’Arnaud Orain. Ils illustrent le retour d’un « capitalisme de la finitude » qui, loin de prôner la sobriété, légitime la prédation par l’intermédiaire de compagnies-États…
– Pour débuter cet entretien, je souhaiterais souligner la parfaite synchronicité de la date officielle de parution de votre livre – le 22 janvier 2025 – avec des événements de l’actualité immédiate : les déclarations de Trump au sujet du Canal de Panama, du Groenland et du Canada, et son investiture dont je retiens notamment cette photos donnant à voir les figures de la Tech alignés d’une manière qui n’est pas sans évoquer un acte d’allégeance à l’égard du nouveau pouvoir. Des faits d’actualité qui ne manquent pas de sidérer tant ils semblent traduire le basculement dans un monde complètement fou, mais dont votre livre donne un éclairage qui en atteste la cohérence en montant qu’ils manifestent le retour en force d’une forme particulière de capitalisme, ce que vous appelez le « capitalisme de la finitude ». Comment réagissez-vous à cette réaction de lecteur ?
Arnaud Orain : Effectivement, mon livre peut apporter un éclairage à cette actualité brûlante marquée par cet alignement étrange de prime abord, mais qui ne l’est pas autant que cela, entre la réélection de Donald Trump et l’allégeance, c’est le mot, des dirigeants de sociétés qui ne sont autres que ce que j’appelle des « compagnies-États, et ce dès avant l’investiture du premier, les choses n’ayant fait que se confirmer depuis.
Ce livre est cependant un livre d’histoire : il fait état et tente d’expliquer ce qui est en train de se produire à l’aune de cinq siècles de capitalisme. Sa publication en ce mois de janvier 2025 n’est pas anodine au sens où je tenais à ce qu’il paraisse rapidement puisque j’étais plutôt convaincu que le moment Trump allait revenir. Il me semblait en effet qu’il était plus que temps d’expliquer que ce moment ne traduit pas un changement total du capitalisme. Pour le comprendre, il faut cette fois s’extirper de l’actualité la plus brûlante. On voit alors que ce moment Trump est le symptôme autrement plus puissant d’une même maladie déjà à l’œuvre durant les administrations Trump 1 et Biden.
Rappelons que cette dernière n’est pas revenue sur certains droits de douane instaurés par l’administration Trump. Elle les a même parfois rehaussés. C’est elle aussi qui a mis en place l’Inflation Reducation Act, qui n’est autre qu’un subventionnement massif pour inciter les entreprises à relocaliser leur production aux États-Unis. Cette même administration Biden a mis en place bien d’autres politiques économiques avec le même objectif de relocaliser des activités de production industrielle aux États-Unis sinon chez des pays amis – en vertu du fameux « Friendshoring » de Janet Yellen, l’ancienne secrétaire au Trésor Rappelons encore que la représentante au Commerce de Biden, Katherine Thai, a expliqué à longueur d’interviews qu’elle n’était pas en désaccord avec Bob Lightizer, celui-là même qui a inspiré le programme économique de Trump 1, qu’elle faisait le même constat sur le fait qu’il fallait privilégier la production sur la consommation, revenir à la puissance faute de parvenir à l’abondance pour tous. Autant de personnalités, de responsables politiques, qui inclinent dans le sens d’une remise en cause du néolibéralisme, qui confiait à l’État ou une organisation supranationale le soin d’édicter des règles très strictes pour faire fonctionner une économie hautement concurrentielle et multilatérale, à travers l’abaissement des droits de douane, une destruction des monopoles, des cartels et des ententes ; un primat accordé à la consommation, à la baisse des prix, etc. On n’est plus dans ce monde néolibéral qui s’était imposé à partir des années 1970-1980.
– Ce qui s’impose désormais, c’est ce que vous appelez le « capitalisme de la finitude ». Nous laisserons le soin aux lecteurs d’en découvrir les facettes. Ce qu’on peut en dire, c’est que c’est un capitalisme qui prend acte de la finitude des ressources, mais sans en tirer la conclusion d’une nécessaire sobriété…
Arnaud Orain : Avant d’y venir, précisons que nous avions dans les tiroirs une notion que d’aucuns invoquent pour décrire le monde qui vient, c’est celle de « mercantilisme » qu’on oppose au libéralisme économique. Cette notion a été développée au XVIIIe siècle par Adam Smith et le Marquis de Mirabeau qui parlaient de « système mercantile » pour désigner ce qui aurait été la doctrine des grands négociants ayant investi l’État monarchique français et anglais et conduit à favoriser l’industrie, le commerce au long cours et, avec lui, les armateurs, en créant un certain nombre de réglementations et droits de douane, en recourant aux subventionnements, etc., au détriment de l’agriculture et, bien sûr, de la liberté du commerce. À la fin du XIXe siècle, d’autres auteurs – Gustav Schmoller puis Eli Heckscher ont invoqué ce mercantilisme, mais en l’expliquant en des termes un peu différents : il participerait à la construction d’États-nation – ceux de la France et de la Grande-Bretagne en particulier – à travers l’instauration de systèmes de droits de douane, la centralisation des administrations, le subventionnement et la protection de l’industrie, le développement d’une marine – un levier essentiel sur lequel nous aurons sans doute l’occasion de revenir. Le mercantilisme, nous dit Schmoller, au tout début du XXe siècle, est une politique de la mer, de construction d’une puissante marine de guerre et marchande, allant de pair avec la poursuite de conquêtes coloniales.
– Est-ce que je simplifie à outrance les principes de ce mercantilisme qui, notons-le au passage, est hétéroclite, en considérant que s’il encourage la production nationale et le protectionnisme, c’est dans l’idée de préserver les ressources financières dont l’État a besoin pour financer ses efforts de guerre ?
Arnaud Orain : Vous mettez justement le doigt sur le problème : on a trop souvent du mercantilisme une définition comme celle que vous venez de résumer – une pratique de construction de l’État-nation via un système de captation des richesses par le truchement de la levée d’impôts, de droits de douanes, etc, grâce à un développement économique impulsé par l’État, et en se focalisant sur le protectionnisme. C’est pourquoi j’ai voulu opter pour un autre concept.
– De fait, le mot même de mercantilisme n’apparaît qu’à deux reprises sous votre plume – la première fois pour expliquer pourquoi vous souhaitez y renoncer…
Arnaud Orain : Si j’ai voulu y renoncer, c’est parce que trop souvent, le mercantilisme a été, comme je viens de le dire, associé à l’impulsion et la construction des économies nationales par les États-nation. Or, je pense que cette vision ne rend pas compte de ce qui se passe aujourd’hui et qu’on observait déjà aux XVIe-XVIIIe siècle, à savoir une période de fragmentation de la souveraineté. Les acteurs étatiques ne sont pas les seuls à être à la manœuvre du capitalisme. Jouent également un rôle majeur les grandes compagnies de commerce. Je voulais donc sortir de la vision classique du mercantilisme, en proposant un autre concept opposé au libéralisme – aux libéralismes devrait-on dire.
Pour mémoire, ces derniers sont porteurs d’une promesse, qu’on peut juger fallacieuse tant elle paraît irréaliste, mais qui n’en est pas moins celle d’une croissance des richesses tant au niveau individuel qu’au niveau national et au niveau mondial. Autrement dit, la promesse suivant laquelle on va pouvoir faire croître la taille du gâteau. Comment ? En libéralisant tous les échanges, les marchés – des biens et des services, du travail, etc. C’est vrai du libéralisme classique de la fin du XVIIIe-début XIXe siècle, et du libéralisme « encastré » après 1945. Et cela reste vrai du néolibéralisme encore à l’œuvre à la fin des années 1990 et de sa promesse d’une « mondialisation heureuse » ou de la « terre plate » (selon les mots du journaliste Thomas L. Friedam), de la sortie de la pauvreté d’un grand nombre de pays, et mieux encore, de la plupart des classes laborieuses de ces pays qu’on rangeait il y a peu encore dans le Tiers monde.
Finalement, cette promesse des libéralismes, puis du néolibéralisme, se fracasse à chaque fois sur une autre conviction, celle de la finitude, l’idée selon laquelle en réalité « il n’y en aura pas pour tout le monde ». Autrement dit, le gâteau ne pourra réellement grossir.
– De prime abord, ce constat que fait le capitalisme de la finitude pourrait être une bonne chose, en nous incitant à plus de sobriété. Sauf qu’en réalité, il ne renonce pas à un enrichissement quitte à ce qu’il ne profite qu’à une minorité en faisant valoir de surcroît la raison du plus fort…
Arnaud Orain : En effet. Qu’il s’agisse des individus, des États et du monde dans son ensemble, on ne peut s’enrichir qu’en pratiquant la prédation de son voisin… Dans la première phase du capitalisme des XVIe-XVIIIe siècles, au temps des prétendues « Grandes découvertes », les États européens sont lancés dans une course : c’est à celui qui s’appropriera de « nouvelles » terres, avant les autres, pour augmenter sa puissance. À la fin du XIXe siècle, début XXe, se pose la question de la soi-disant « bombe démographique », qui incite de nouveau à s’approprier des terres, des ressources, pour répondre aux besoins d’une population qui va en augmentant, ce qui correspond à une nouvelle course dans la colonisation. Aujourd’hui, on pourrait avoir un espoir : que la finitude se fracasse à son tour sur les limites écologiques de la planète ; cette fois-ci, on pourrait se dire que cette finitude pourrait poser des contraintes positives en nous obligeant à revoir nos modes de production et de consommation, nous conduire à la sobriété, à une prise de conscience que l’accroissement illimité des richesses est une illusion des libéralismes et de la nécessité d’organiser le monde autrement. Pourtant, ce n’est pas ce qui se passe…
– Comment l’expliquez-vous ? N’est-ce pas en raison du retour de ce que vous appelez les « compagnies-États », qui, aux XVIe-XVIIIe siècles, et même jusqu’à la première partie du XXe siècle se présentent sous la formes des compagnies de commerce avec les Indes orientales, et qui, aujourd’hui, s’incarneraient sous la forme des plateformes numériques et autres GAFAM…
Arnaud Orain : En effet. Pour le moment, plusieurs faisceaux d’éléments conduisent au fait que la finitude ne s’incarne pas dans une politique écologique majeure. D’abord, la volonté qu’on observe dans les pays occidentaux d’une préservation d’un niveau de vie confortable, qui incline à poursuivre l’exploitation de ressources fossiles. De leur côté, les pays émergents aspirent à atteindre un niveau de vie équivalent. Ce qui se traduit par une course à l’industrialisation, qui, là encore, passe par le recours à des énergies fossiles, mais aussi par plus de consommation de viande et, donc, d’élevage intensif, par un accaparement de terres d’outre mer – ce qu’on appelle les « hectares fantômes ». De fait, il est difficile d’expliquer à des populations qui sont en passe de sortir de la pauvreté, qu’il leur faut maintenant se mettre à la « sobriété heureuse », et à celles des pays dits développés, qui ont l’habitude d’un niveau de vie relativement élevé, qu’il leur faut y renoncer sans attendre.
Deuxième explication : de nouvelles firmes sont apparues, qui n’ont plus grand-chose à voir avec les firmes multinationales du capitalisme libéral et néolibéral, il ne s’agit même plus d’entreprises privées au sens où on l’entendait jusqu’ici. À ce propos, Mark Zuckerberg est probablement le plus lucide quand il nous dit que Facebook, aujourd’hui Meta, ressemble plus à un « gouvernement » qu’à une entreprise traditionnelle… Le fait est, avec Meta comme avec d’autres Gafam, qu’on n’a plus affaire à de simples entreprises privées ou multinationales – je crois que ce vocabulaire est devenu obsolète. Il faut reparler de « compagnies-États » comme celles qui existaient aux XVIe-XVIIIe siècles avec les Compagnies des Indes : des institutions qui sont à la fois marchandes et étatiques, c’est-à-dire qui possèdent des attributs régaliens et souverains – des flottes, des entrepôts, etc. dans le cas des Compagnies des Indes ; des satellites, des câbles sous-marins, des plateformes numériques, etc., dans le cas des compagnies-États actuelles, dont les patrons sont traités comme des chefs d’État, ont des pouvoirs de manipulation de l’information, de création et de distorsion de l’espace public…
– Et, comme des chefs d’État, invités à l’investiture d’un président…
Arnaud Orain : C’est là que l’image que vous avez évoquée au début de cet entretien prend tout son sens. Ces dirigeants de la Tech n’ont aucun intérêt à ce que nous allions vers la sobriété heureuse. Ils ont non seulement besoin de faire des profits, mais encore se pensent comme des demi-dieux, en vertu de l’idée schumpétérienne que les entrepreneurs sont des transformateurs de la société et même du monde. Ils ont en cela une vision qui va au-delà de la quête d’une maximisation de leur profit.
– Ces Gafam ont un autre trait commun avec les compagnies-États : le recours à des formes d’exploitation esclavagiste – je pense à ces digital workers qu’Antonio Casilli met en lumière dans son livre En attendant les robots[1]…
Arnaud Orain : Pour cette autre raison, il est temps de remettre en cause l’historiographie classique des Compagnies des Indes, car elle en a trop insisté sur la magnificence des produits – porcelaines, soieries et autres étoffes – et sur la figure héroïque des navigateurs, tout en escamotant les aspects les plus sombres. Autant le dire, ce récit m’agace. Ces compagnies ont en réalité d’abord incarné des formes violentes de pouvoir. À elle seule, la compagnie des Indes orientales néerlandaises, c’est des dizaines de milliers de personnes esclavagisées ou soumises. Son homologue anglaise n’a rien à lui envier : elle fut une entreprise sanglante de conquêtes…
– Des compagnies qui, de surcroît, ne produisaient rien…
Arnaud Orain : Disons pas grand-chose. Quoi qu’il en soit, il faut sortir de la whig history, cette histoire fantasmée, en forme de contes pour enfant, d’entreprises multinationales qui auraient favorisé, dans l’intérêt du monde civilisé, le déploiement du capitalisme moderne, occidental, grâce à des institutions efficaces, un esprit aventurier, etc. La violence dont elles ont fait preuve a été inouïe. Certes, on ne peut pas faire ce procès aux grandes plateformes numériques. Mais pour être moins manifeste, elles n’en imposent pas moins, on vient de le dire, un travail semi-contraint qui, lui aussi, est invisibilisé comme l’avait été celui imposé par la VOC (pour Vereenigde Oost-Indische Compagnie), fondée en 1602.
Propos recueillis par Sylvain Allemand
Pour accéder à la suite de l’entretien, cliquer ici.
[1] En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Seuil, 2019.